I Alain Lestié : ut mimesis, pictura
S'il y avait une généalogie à retracer dans la peinture d'Alain Lestié, ce devrait être celle de la couleur, progressivement libérée en son œuvre.
D'abord issus d'une littérale « sciagraphie1» qui les contenait entre gris, beiges et bruns, les tableaux de ce peintre semblent s'être peu à peu laissé configurer par l'éclatement de celle-ci en tons plus vifs et brillants — selon la précaution d'une vigilance, proprement (étymologiquement), théorique.
Car ici la couleur ne coule pas ni ne vibre; non plus qu'elle n'illustre ou n'enlumine. Elle n'inaugure pas davantage quelque récit par contrariété dialectique; et ne s'inféode à aucun ordre de vision « en profondeur » préexistant à la confection du tableau (voyance symbolique, intuition de la matière, ou exploration du pulsionnel — comme on a dit). Elle se fait, bien plutôt, milieu de différence où s'ajointent les divers fragments d'images sur la toile, constituant à la fois l'agencement et la tension de leur être-ensemble représentatif. Force disjonctive de l'entre, elle instaure leur entrevue et instruit leur entretien.
***
Peintre moderne, et partant, universel, Lestié peut aussi être appelé peintre français.
Comme l'on parle d'un opéra français spécifique (de Lully à Bizet, de Rameau à Debussy), par-delà la langue, pour la clarté générale de l'énonciation et la justesse, chaque fois particulière, de la prosodie. Soit le calcul pointilleux des rapports connexes de valeurs et de quantités — là : sons, rythmes et mots; ici : lumières, formes et tons.
A la façon, encore, dont Mallarmé écrivait à propos de la « main » de Manet, que « la pression sentie claire et prête énonçait dans quel mystère la limpidité de la vue y descendait, pour ordonner, vivace, lavé, profond, aigu ou hanté de certain noir, le chef-d'œuvre nouveau et français2 ».
Au sens, enfin, où le corpus des tableaux de Lestié subsume diverses manières de représenter prégnantes dans l'histoire de la peinture française. Entre autres : I'allégorie selon Caron, dont l'implicite succession temporelle se déjoue en espace; la scénographie de Poussin, rhétorique jusque dans la découpe des plans; les cadrages de sites à la Lorrain, comme autant d'embrasures du regard; le fréquent tremblement entre vues simulées et « tableaux vivants », par où l'on remonterait de Balthus à Tonnerre, si de ce dernier — peintre du XIXe trouvé par Klossowski — demeurait quelque toile (alors qu'il faut s'en remettre aux seuls aperçus qu'en donne cet auteur dans La Révocation de l'Édit de Nantes 3); et puis ce vernis en glacis qui, tel celui des artistes anonymes bellifontains, en son éther luminescent, accoutume de sa distanciation une érotique du secret.
***
Lestié propose donc de la figuration. Et même fort remarquable par la minutie méticuleuse des reproductions d'objets, de paysages et de corps — toutes techniques du trompe-l'œil maîtrisées, des fresques de Pompéi aux toiles de Magritte. De sorte que l'on est fondé à lire aussi dans cette peinture une description “réaliste” de l'univers. Quitte à revoir la notion avec l'aide de Barthes : «Toute description littéraire est une vue. On dirait que l'énonciateur, avant de décrire, se poste à la fenêtre, non tellement pour bien voir, mais pour fonder ce qu'il voit par son cadre même : l'embrasure fait le spectacle. Décrire, c'est donc placer le cadre vide que l'auteur réaliste transporte toujours avec lui (plus important que son chevalet), devant une collection ou un continu d'objets inaccessibles à la parole sans cette opération maniaque (qui pourrait faire rire à la façon d'un gag); pour pouvoir en parler, il faut que l'écrivain, par un rite initial, transforme d'abord le “réel” en objet peint (encadré); après quoi il peut décrocher cet objet, le tirer de sa peinture : en un mot : le dé-peindre (dépeindre, c'est faire dévaler le tapis des codes, c'est référer, non d'un langage à un référent, mais d'un code à un autre code). Ainsi le réalisme (bien mal nommé, en tout cas souvent mal interprété) consiste, non à copier le réel, mais à copier une copie (peinte) du réel : ce fameux réel, comme sous l'effet d'une peur qui interdirait de le toucher directement, est remis plus loin, différé, ou du moins saisi à travers la gangue picturale dont on l'enduit avant de le soumettre à la parole : code sur code, dit le réalisme. C'est pourquoi le réalisme ne peut être dit “copieur” mais plutôt “pasticheur” (par une mimesis seconde, il copie ce qui est déjà copie)4 ».
Suivant cette optique, le réalisme propre à Lestié consiste à tirer les codes picturaux de la mimesis littéraire (alentour de Mallarmé, Blanchot, des Forêts, Klossowski, si l'on veut), pour les restituer, en tant que stéréotypes, à la peinture. Cadres sur codes, dit Lestié, en agençant de la sorte ces copies (déjà peintes et “lues”) du réel que représentent les images qu'il ex-pose, en entier ou par morceaux.
D'où se marque un tour supplémentaire de la parodie désoriginant le modèle5 , qui fonde son entreprise picturale. Laquelle œuvre ainsi à faire passer la vue de la réalité dé-peinte à l'image re-peinte. En quoi elle procède d'un effet d' « après-coup 6», puisque ledit modèle ne vient à existence qu'à travers la parodie qu'en dispose le tableau accompli.
***
On réduirait le travail de Lestié, si l'on ignorait, outre sa connaissance exhaustive de la peinture qui le précède, son amour du cinématographe7: il voit en lui un volumineux répertoire d'images articulées, complétant l'archive des stéréotypes qu'il combine. Il s'ensuit que, à travers l'interpénétration ou la surimpression de motifs picturaux et de plans « filmiques » (selon un constant renvoi de clichés en citations fictives), l'ensemble de ses toiles fonctionne sur le mode d'un vaste palimpseste où le visible est toujours repercé par le déjà-vu. Cependant que s'y prolonge et s'en accroît l'intertexte visuel.
Pourtant, cette peinture ne se contente pas d'assurer une gestion de l'antérieur, si subtilement parodique soit-elle. Loin de consommer des images — comme le fit, jusque dans l'acquiescement extatique à leur défilé, l'hyperréalisme américain des années 70 (avec lequel Lestié n'a, littéralement, rien à voir) — cet artiste s'efforce de les consumer en les menant à leur perte. C'est-à-dire d'en perdre la mémoire. Et l'on sait (au moins depuis Nietzsche) que la mémoire ne se perd pas dans l'oubli, qui contribue au contraire à sa continuation, mais dans la démultiplication nombreuse du souvenir, par échos, reflets ou simulacres. D'où vient ce pluriel, diabolique (la fragmentation ou “diabole8” lutte, ici, contre l'unification symbolique), d'éclats de vue(s), qui institue en même temps la collection des toiles signées Lestié en pinacothèque de Babell9 .
Dès lors, puisque cet artiste entend faire œuvre plutôt que rien, le voici contraint de canaliser ce qui serait pure perte en dépense qui dure (et motive la production séquentielle de ses tableaux) : non pas offusquer massivement la représentation, mais la miner, la mimant, d'un faufil de légères subversions.
***
S'il existe, aujourd'hui, un peintre unheimlich 10, c'est bien Lestié, capable d'inquiéter jusqu'à l'étrangeté notre familiarité manifeste avec le monde qu'il montre, pour la mieux défaire.
Quant à la vision : le boitement des perspectives, I'équivoque profilement des scènes, les multiples fractures de cadrage, I'intrusion de l'encadrement peint sur la toile, etc., creusent celle-ci d'autant d'hiatus, dont la somme d'impossibilités destitue le visible offert de ses ordonnances ordinaires : nous ne savons plus comment (et d'où) le voir, encore moins le lire.
Quant à la com-position : les éléments qui s'y trouvent ensemble ne vont pas, ensemble, vers une totalisation qui puisse consister. Partant, le sens s'amuït entre différentes amorces de récits possibles en même temps que s'indétermine la semblance générale de cette peinture.
Quant au référent : (se) donnant pour objet originaire un réel qui comparaît uniquement, en fait, au travers de stéréotypes ainsi disposés d'emblée en comparants, ladite peinture, échelonnée en codes et par avance imagée, s'opacifie dans le labyrinthe de sa référence déjà peinte, tandis que sa trame impose l'effet d'une catachrèse généralisée 11.
À quoi s'ajoute l'insolite double inscription du temps qu'opère cette peinture. D'abord sous forme d'alliance contradictoire, tel un oxymore, lorsque certaines toiles, rassemblant des objets d'époques différentes (ruines antiques et portiques récents, par exemple), ne les assemblent en aucune perspective déterminée. Si bien que seule insiste, et d'une surface l'autre persiste, une co-présence antithétique sans métonymie narrative assignable; tandis que le temps historique paraît fragmenté en divers espaces allégoriques déliés. Tout se passe alors comme si le tableau nous disait (avec Baudelaire) « J'ai plus de souvenirs que si j'avais mille ans », dans le moment même où, replié sur son énigme, il se mue en « un vieux sphinx ignoré du monde insoucieux12 ».
Ensuite, selon une vaste oscillation réversible entre un passé et un futur intrinsèques aux tableaux. De fait, mêlant à leur motif ou diégèse implicite différentes figurations d'esquisses (croquis, feuilles de notes, photos, repères chiffrés ou écrits plus ou moins lisibles) en autant de brouillons préparatoires (comme si -- à la manière du narrateur beckettien procédant souvent par corrections de son énoncé -- l'avant-texte pénétrait dans le texte pour le constituer en partie), telles toiles semblent comporter la genèse du tableau, dont le passé se fond ainsi et se résorbe dans l'achèvement présent qu'elles donnent à voir. Cependant qu'à la surface de telles autres, alors quasiment projetées vers leur avenir d'exposition, Lestié, tel Dappertutto ensorcelant Hoffmann, est parvenu à capter le reflet de leur spectateur pour l'inscrire en ombre portée.
Dès lors, cernée par l'étrangeté que cette peinture sécrète au sein de sa visibilité, la présentation de l'univers s'altère irrémédiablement. C'est ainsi que Lestié traduit, pour notre époque l'affirmation baudelairienne : « Le Beau est toujours bizarre 13 ».
***
Mus par une authentique « passion de l'image », les tableaux de Lestié entrent dans le champ de la fascination, telle que la décrit Blanchot : « La distance n'en est pas exclue, mais elle est exorbitante, étant la profondeur illimitée qui est derrière l'image, profondeur non vivante, non maniable, présente absolument, quoique non donnée, où s'abîment les objets lorsqu'ils s'éloignent de leur sens, lorsqu'ils s'effondrent dans leur image. Ce milieu de la fascination, où ce que l'on voit saisit la vue et la rend interminable, où le regard se fige en lumière, où la lumière est le luisant absolu d'un œil qu'on ne voit pas, qu'on ne cesse pourtant de voir, car c'est notre propre regard en miroir, ce milieu est, par excellence, attirant, fascinant 14 ».
De fait, sur chaque toile, l'image — diffractée, hantée par son hors-champ, et comme expropriée par sa propre citation — ne cesse de se déporter hors d'elle-même. Par quoi acheminant d'une toile l'autre sa désorganisation originaire (le désastre dont elle procède), cette œuvre picturale se « désœuvre 15 » sans fin.
Si bien qu'un tel passage à la limite (où se disperse l'unité de l'œuvre, s'indétermine son accomplissement et se perd la possibilité de sa clôture) évoque nécessairement le mythe d'Orphée et de son « regard » en quête d'Eurydice, relu aussi par Blanchot en direction de l'œuvre d'art et, en particulier, de la littérature : « L'œuvre est tout pour Orphée, à l'exception de ce regard désiré où elle se perd, de sorte que c'est aussi seulement dans ce regard qu'elle peut se dépasser, s'unir à son origine et se consacrer dans l'impossibilité.
Le regard d'Orphée est le don ultime d'Orphée à l'œuvre, don où il la refuse, où il la sacrifie en se portant, par le mouvement démesuré du désir, vers l'origine, et où il se porte, à son insu, vers l'œuvre encore, vers l'origine de l'œuvre.
Tout sombre alors, pour Orphée, dans la certitude de l'échec où ne demeure, en compensation, que l'incertitude de l'œuvre, car l'œuvre est-elle jamais? Devant le chef-d'œuvre le plus sûr où brillent l'éclat et la décision du commencement, il nous arrive d'être aussi en face de ce qui s'éteint, œuvre soudain redevenue invisible, qui n'est plus là, qui n'a jamais été là. Cette soudaine éclipse est le lointain souvenir du regard d'Orphée, elle est le retour nostalgique à l'incertitude de l'origine 16.».
Ainsi, stance de la fascination dans l'espace, désœuvrement opérant dans le temps, la peinture de Lestié se fait théâtre, autant que théorie, de l'intenable. Elle affronte celui qui la regarde au vertige d'apesanteur, puisqu'il perd les centres de gravité de sa vision et de son désir : en l'une, s'estompe la visibilité comme pouvoir de nommer les scènes, désigner les motifs, attribuer le sens; face à l'autre, se dérobe l'objet sous un apparaître incertain. Si bien que le spectateur se voit dépossédé des moyens de peser (sur) le tableau : identifier, discerner, raconter.
Autrement dit : emporté en une vue improbable, dont l'espace se dédouble, le propre se simule, le désir se disperse, et où seule se dispose une apparence de mémoire impersonnelle, c'est le sujet même du regard — notre sujet — qui vacille, voyeur surpris, abstrait de son imaginaire.
Alors, par intermittences, réverbérant notre vertigineuse déception au miroir de la surface peinte, la mimesis dévoile, ici, l'envers de son semblant : le rapport à l'imprésentable qui lui donne lieu. Sous l'effet d'une représentation, en laquelle la présence (du sens, du désir satisfait, de la vue fixée — selon la double acception du terme) se diffère indéfiniment, uniquement postulable, si l'on y tient, comme dérivé second ou dérivation secondaire de ce qui est censé la représenter. Et l'on perçoit que, sous l'apparence figurative familière, ce peintre ne donne figure à rien d'autre qu'à l'infigurable même : l'insondable mimique latente — figurante parce que défigurante, et inversement — par quoi se (re)produit la mimesis 17.
Manœuvre limite, par quoi l'objet (de la) peinture apparaît neutralisé en son être même, et qui implique ceci (en paraphrasant Blanchot, encore) : il se pourrait que peindre à la façon de Lestié, ce soit attirer la peinture dans une possibilité de montrer qui montrerait sans montrer l'être et sans non plus le dénier18 . Suspension neutre du pictural, où ce dernier devient «célibataire» de lui-même.
***
A l'encontre des fadeurs et fadaises de l'actuel discours « culturel 19», qui ont dévalué la chose avec le mot, il faut affirmer le caractère tragique de la peinture de Lestié.
Non seulement pour la violence sourde qui y affleure, à travers le rapt d'images et leur enfermement parodique, l'apparition de stèles sombres ou de murs gris coupant la vue, la percée de phantasmes supports d'indécidables désirs (nus offerts, silhouettes pétrifiées, gestes surpris, corps morcelés), l'intrusion d'images-écrans barrant l'apparence du souvenir (réel ou fictif), l'effritement d'inscriptions, voire de scènes, venu de quelque catastrophe de l'espace ou du temps -- autant d'effets d'un « calme bloc ici-bas chu d'un désastre obscur 20 », maintenus comme en suspens(e) sous le couvercle du vernis qui les fixe, tel le contrechamp de cette violence : revers violent refoulant de sa parure lisse ce qui tend précisément à la briser.
Mais surtout parce que, s'il est vrai, comme l'écrit Derrida, que « penser la clôture de la représentation, c'est penser le tragique : non pas comme représentation du destin mais comme destin de la représentation. Sa nécessité gratuite et sans fond 21 », et, comme l'a pressenti Hölderlin, que le tragique commence avec la perte des modèles, alors une telle peinture non seulement nous re-présente cette perte, mais ne (sur)vit que d'elle.
Il s'agit là, bien sûr, d'une affaire interminable. Dans le cours de laquelle Lestié dérange la croyance en deux mythes tenaces : l'achèvement de la peinture, à quoi l'on prétend çà et là, se révèle une illusion; aussi bien que la proclamée mise à mort de l'image — de tout ce qui finit par faire image (non-figuration et abstraction comprises) dans le cadre du tableau. De fait, toutes les toiles de ce peintre participent, en le manifestant radicalement, de l'étonnement — sans doute le seul justifié en la matière — qu'il y ait, encore et toujours, « de » l'image.
Ce pourquoi Lestié, dans cette diction d'infini où il maintient son œuvre, opère autrement : dévoué à la ruine de la mimesis picturale, mais non à sa suppression, il la prend au pied de la lettre (ou de l'essence, si quelque chose de tel existe), en sur-exposant ce qui la constitue : la dépropriation même du visible.
Une telle œuvre, on l'aura compris, ne relève d'aucune forme d'empirie masquée d'éclectiques à-peu-près théoriques, mais d'une réflexion endurante, inhabituelle autant qu'intempestive. De ce retraithors de toute mode, on tirera (conviant, un instant, l'italien à enter le français) le portrait d'un artiste inexorable : Lestié séjourne à ce point en (« sa ») peinture, que l'entier de son existence se déduit de celle-ci et s'épuise en elle.
Finalement, la beauté propre de cette peinture — ce qui la rend unique à mes yeux — vient du singulier clivage dans lequel elle emporte le regard.
D'un côté, derrière le vitrage du vernis, le feuilleté des images, et le leurre de la semblance, elle s'éloigne de nous, à perte de vue, muette et labile, se dérobant telle une immémoriale peinture du rêve. Comme l'entend Borges : « Quelqu'un me dit : “Tu ne t’es pas réveillé à la veille, mais à un songe antérieur. Ce rêve est à l'intérieur d'un autre, et ainsi de suite à l'infini, qui est le nombre des grains de sable”22 » . Mais aussi, Blanchot (une dernière fois) : « Le rêve touche à la région où règne la pure ressemblance. Tout y est semblant, chaque figure en est une autre, est semblable à l'autre et encore à une autre, et celle-ci à une autre. On cherche le modèle originaire, on voudrait être renvoyé à un point de départ, à une révélation initiale, mais il n'y en a pas : le rêve est le semblable qui renvoie éternellement au semblable23. ». Soit alors, entre le rêve sans fin qu'elle sécrète et le vernis cristallin qui la nimbe, la qualité proprement poétique de cette peinture : « La poésie est quelque chose de profond et de miroitant comme le rêve, de mystérieux et parfait comme le cristal.» (Baudelaire).
Cependant que, de l'autre côté, elle nous affecte de profondes touches “trouant” la représentation : par le filigrane de lumière dont la couleur est ici toujours grosse, le recueil ou le recel d'objets erratiques, la gravure des visages et des corps (féminins) selon la force d'un « désir demeurant désir », voici que sa texture séduit l'œil d'une proximité ravivant la promesse d'un nouveau voir. D'où vient alors la chance de cette peinture : le transport des clichés anonymes autant que des métaphores subjectives - soit la phorie d'images - devient euphorie : à la fois bonheur pictural et bien éthique, réalisant ainsi un précepte de Valéry : « Il ne faut demander au ciel que l'euphorie, et les moyens de s'en servir 24».
C'est de la libration perpétuée en ce double regard obligé, que provient l'impact, sans doute le plus intime, des tableaux de Lestié : fine déhiscence de la vue ouvrant en nous la blessure de l'événement, par lequel, entre le déjà-vu du rêve et l'à-voir qui se réserve en s'annonçant, cette peinture nous advient, ici et maintenant, comme l'avenir même.
Jean-Pierre Moussaron

issue de secours

emploi du temps
notes
1- C'est par ce terme, on le sait, que Platon désigne la peinture (République 365 c, Critias 407 c, etc.). Soit, littéralement : “gravure d'ombre”, que le dictionnaire Bailly traduit (et développe) ainsi : « dessin ou peinture avec une juste distribution d'ombre et de lumière, d'où dessin en perspective ».
2-Dans Médaillons et portraits, Œuvres complètes, éd. Henri Mondor et G. Jean-Aubry, Paris, Gallimard, 1945/1965, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », p. 533.
3- Premier récit de la trilogie Les lois de l'hospitalité (Paris, Gallimard, 1965), dans lequel la première mention du peintre Tonnerre apparaît p. 15.
4-Dans S/Z, Paris, Le Seuil, 1970, p. 61. Réédité en coll. « Points », 1976, p. 56.
5-Sur cette question, je renvoie une fois pour toutes au livre indispensable de Jean-Marie Pontévia et Alain Lestié : Travaux d'après peinture, Toulouse, T.E.R., 1981. Et, notamment, p. 27 à 46.
6-Voir, quant à cette notion empruntée à Freud, t. I, Introduction, p. 29 et n. 1.
7-Au sens fort que Robert Bresson donne à ce terme : « Le cinématographe est une écriture avec des images en mouvement et des sons. », in Notes sur le cinématographe, Paris, Gallimard, 1975, p. 12. Pour une définition plus étendue, dans laquelle ce cinéaste oppose le « cinématographe » au « cinéma », voir, inf., ch. V, p. .
8-On se rappelle que dans les Écritures le Diable se présente en déclarant : «Mon nom est Légion». Mais aussi que son étymon, «diabole», est le nom grec ancien de la désunion. Voir inf., ch. V, p. .
9-Pour transposer ici le mythe borgésien de « La Bibliothèque de Babel », lisible dans Fictions, tr. P. Verdevoye et N. Ibarra, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, 1993, coll. « Bibliothèque de la Pléiade», t. I, p. 491 à 498. Quant à ce mythe, voir t. I, Introduction, p. 22, n. 2 et 3.
10- Selon la terminologie freudienne : voir t. I, Introduction, p. 37, n. 2, et p. 38.
11- À entendre selon la définition de Barthes : « Il y a une figure de rhétorique qui restitue [le] blanc du comparé, dont l'existence est entièrement remise à la parole du comparant : c'est la catachrèse (il n'y a aucun autre mot possible pour dénoter les “ailes” du moulin ou les “bras” du fauteuil, et pourtant les “ailes” et les “bras” sont, tout de suite, déjà, métaphoriques) : figure fondamentale, plus encore que la métonymie, puisqu'elle parle autour d'un comparé vide », dans S/Z, op. cit., p. 41. Pour une citation complète, reliant cette figure à l’impossible description directe de la « beauté », voir, t. I, ch. V, p. 178, n. 2.
12-Vers extraits de « Spleen [2] », dans Les Fleurs du mal, Œuvres complètes, t. I, éd. Claude Pichois, Paris, Gallimard, 1975, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », p. 73.
13-Dans Exposition Universelle de 1855, Œuvres complètes, op. cit., t. II, p. 578.
14-Dans L'Espace littéraire, Paris, Gallimard, 1955, p. 23-24.
15-Au sens exploré et acheminé par Blanchot dans ses essais critiques, notamment L'Espace littéraire (op. cit.) et L'Entretien infini (Paris, Gallimard, 1969), passim.
16-Dans L'Espace littéraire, op. cit., p. 182-183.
17-Pour cette rencontre implicite avec la pensée de Derrida, voir, sup. , ch. I, p.
18-La phrase originale se trouve dans L'Entretien infini, (Paris, Gallimard, 1969, p. 567), à propos de la « voix narrative » et de « l'écriture » : « Mais il se pourrait que raconter (écrire), ce soit attirer le langage dans une possibilité de dire qui dirait sans dire l'être et sans non plus le dénier.». Par quoi, en même temps, apparaît marquée, jusque dans son effet profond, l'évidente proximité de la peinture de Lestié avec la littérature ainsi conçue à sa plus haute mesure.
19- Selon le mot et la notion pensés par Deguy au long de son œuvre : voir, tome I, ch. V, p. 193-194.
20-Il s'agit, bien sûr, du vers de Mallarmé ouvrant le dernier tercet du « Tombeau d'Edgar Poe » (Œuvres complètes, op. cit., p. 70). De fait, le rapprochement avec l'œuvre de ce poète paraît ici pertinent, car si Lestié parvient à organiser dans “sa” peinture, non seulement l'amuïssement de la représentation endoxale, l'échancrure du visible et la perte d'adresse à un destinataire préconçu, mais encore la disparition même du peintre en tant qu'identité fixe et propre à un sujet assignable, on peut penser qu'il le doit à une longue méditation de la pensée mallarméenne et à la traversée des opérations de négativité et d'absentement qui la fondent (de « la Destruction fut ma Béatrice » à la « disparition élocutoire » du poète).
21-Dans L'Écriture et la différence, Paris, Le Seuil, 1967, p. 368. Voir, sup., ch. I, p.
22-L'Écriture du Dieu, nouvelle recueillie dans L'Aleph, tr. R. Caillois et R. L.-F. Durand, revue par J._P. Bernès, Œuvres complètes, op. cit., t. I, p. 633-634.
23-Dans L'Espace littéraire, op. cit., p. 282.
24-Dans Tel Quel, Œuvres, t. II, Paris, Gallimard, 1960, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », p. 542.
1- C'est par ce terme, on le sait, que Platon désigne la peinture (République 365 c, Critias 407 c, etc.). Soit, littéralement : “gravure d'ombre”, que le dictionnaire Bailly traduit (et développe) ainsi : « dessin ou peinture avec une juste distribution d'ombre et de lumière, d'où dessin en perspective ».
2-Dans Médaillons et portraits, Œuvres complètes, éd. Henri Mondor et G. Jean-Aubry, Paris, Gallimard, 1945/1965, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », p. 533.
3- Premier récit de la trilogie Les lois de l'hospitalité (Paris, Gallimard, 1965), dans lequel la première mention du peintre Tonnerre apparaît p. 15.
4-Dans S/Z, Paris, Le Seuil, 1970, p. 61. Réédité en coll. « Points », 1976, p. 56.
5-Sur cette question, je renvoie une fois pour toutes au livre indispensable de Jean-Marie Pontévia et Alain Lestié : Travaux d'après peinture, Toulouse, T.E.R., 1981. Et, notamment, p. 27 à 46.
6-Voir, quant à cette notion empruntée à Freud, t. I, Introduction, p. 29 et n. 1.
7-Au sens fort que Robert Bresson donne à ce terme : « Le cinématographe est une écriture avec des images en mouvement et des sons. », in Notes sur le cinématographe, Paris, Gallimard, 1975, p. 12. Pour une définition plus étendue, dans laquelle ce cinéaste oppose le « cinématographe » au « cinéma », voir, inf., ch. V, p. .
8-On se rappelle que dans les Écritures le Diable se présente en déclarant : «Mon nom est Légion». Mais aussi que son étymon, «diabole», est le nom grec ancien de la désunion. Voir inf., ch. V, p. .
9-Pour transposer ici le mythe borgésien de « La Bibliothèque de Babel », lisible dans Fictions, tr. P. Verdevoye et N. Ibarra, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, 1993, coll. « Bibliothèque de la Pléiade», t. I, p. 491 à 498. Quant à ce mythe, voir t. I, Introduction, p. 22, n. 2 et 3.
10- Selon la terminologie freudienne : voir t. I, Introduction, p. 37, n. 2, et p. 38.
11- À entendre selon la définition de Barthes : « Il y a une figure de rhétorique qui restitue [le] blanc du comparé, dont l'existence est entièrement remise à la parole du comparant : c'est la catachrèse (il n'y a aucun autre mot possible pour dénoter les “ailes” du moulin ou les “bras” du fauteuil, et pourtant les “ailes” et les “bras” sont, tout de suite, déjà, métaphoriques) : figure fondamentale, plus encore que la métonymie, puisqu'elle parle autour d'un comparé vide », dans S/Z, op. cit., p. 41. Pour une citation complète, reliant cette figure à l’impossible description directe de la « beauté », voir, t. I, ch. V, p. 178, n. 2.
12-Vers extraits de « Spleen [2] », dans Les Fleurs du mal, Œuvres complètes, t. I, éd. Claude Pichois, Paris, Gallimard, 1975, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », p. 73.
13-Dans Exposition Universelle de 1855, Œuvres complètes, op. cit., t. II, p. 578.
14-Dans L'Espace littéraire, Paris, Gallimard, 1955, p. 23-24.
15-Au sens exploré et acheminé par Blanchot dans ses essais critiques, notamment L'Espace littéraire (op. cit.) et L'Entretien infini (Paris, Gallimard, 1969), passim.
16-Dans L'Espace littéraire, op. cit., p. 182-183.
17-Pour cette rencontre implicite avec la pensée de Derrida, voir, sup. , ch. I, p.
18-La phrase originale se trouve dans L'Entretien infini, (Paris, Gallimard, 1969, p. 567), à propos de la « voix narrative » et de « l'écriture » : « Mais il se pourrait que raconter (écrire), ce soit attirer le langage dans une possibilité de dire qui dirait sans dire l'être et sans non plus le dénier.». Par quoi, en même temps, apparaît marquée, jusque dans son effet profond, l'évidente proximité de la peinture de Lestié avec la littérature ainsi conçue à sa plus haute mesure.
19- Selon le mot et la notion pensés par Deguy au long de son œuvre : voir, tome I, ch. V, p. 193-194.
20-Il s'agit, bien sûr, du vers de Mallarmé ouvrant le dernier tercet du « Tombeau d'Edgar Poe » (Œuvres complètes, op. cit., p. 70). De fait, le rapprochement avec l'œuvre de ce poète paraît ici pertinent, car si Lestié parvient à organiser dans “sa” peinture, non seulement l'amuïssement de la représentation endoxale, l'échancrure du visible et la perte d'adresse à un destinataire préconçu, mais encore la disparition même du peintre en tant qu'identité fixe et propre à un sujet assignable, on peut penser qu'il le doit à une longue méditation de la pensée mallarméenne et à la traversée des opérations de négativité et d'absentement qui la fondent (de « la Destruction fut ma Béatrice » à la « disparition élocutoire » du poète).
21-Dans L'Écriture et la différence, Paris, Le Seuil, 1967, p. 368. Voir, sup., ch. I, p.
22-L'Écriture du Dieu, nouvelle recueillie dans L'Aleph, tr. R. Caillois et R. L.-F. Durand, revue par J._P. Bernès, Œuvres complètes, op. cit., t. I, p. 633-634.
23-Dans L'Espace littéraire, op. cit., p. 282.
24-Dans Tel Quel, Œuvres, t. II, Paris, Gallimard, 1960, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », p. 542.
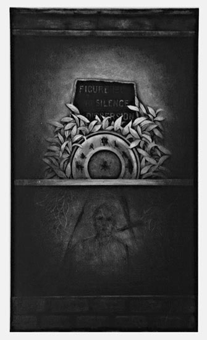
célébration